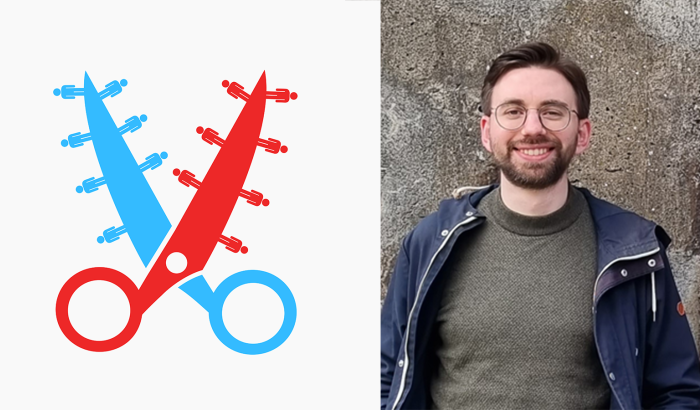Les chercheurs Christine Schiltz et Thomas Lenz de l'Université du Luxembourg ont présenté leur rapport et l'ont débattu avec des parlementaires lors de la conférence « Research meets Politics ».
Le Luxembourg est l’un des membres de l’UE avec la plus grande proportion de gens ayant un diplôme universitaire. Mais c’est aussi l’un des pays européens montrant les plus grandes inégalités en matière d’éducation : le statut socioéconomique et culturel des parents ainsi que la langue parlée à domicile influencent fortement les notes obtenues à l’école, et ainsi le fait d’aller ou non au lycée et à l’université. Ces inégalités touchent en particulier de nombreux enfants issus de l’immigration.
Les conséquences sont à la fois individuelles et sociétales : un parcours scolaire moins performant réduit les chances sur le marché du travail, le revenu et les chances d’une bonne santé, alors que la société voit un pool de talent plus restreint que nécessaire.
Le système scolaire du Grand-Duché se démarque par le fait que les enfants doivent en général composer avec un enseignement trilingue : le luxembourgeois au préscolaire, l’allemand jusqu’à onze ans, puis une part croissante de français, notamment pour l’enseignement des mathématiques et au lycée classique. Avec désormais près de 70% des enfants ne parlant pas le luxembourgeois à la maison, la question de la langue à l’école a pris une importance majeure.
Un nouveau rapport de la cellule scientifique de la Chambre des Députés rédigé par les chercheurs Christine Schiltz et Thomas Lenz de l’Université du Luxembourg fait le point sur ces inégalités et évalue si la diversification des offres de l’école publique peut les réduire. Ce document a été présenté au public et aux parlementaires le 24 mars 2025 lors de la conférence « Research meets Politics » organisée par le FNR et la Chambre des Députés à l’Abbaye de Neumünster. Nous en présentons ici les messages clés.
Un triple fardeau pour les migrants allophones
Les tests internationaux PISA ainsi que les épreuves standardisées à l’échelle nationale révèlent plusieurs types d’inégalités frappantes. Les enfants vivant dans des foyers au statut socioéconomique et culturel les plus et les moins élevés avaient des différences d’environ 80 points dans les tests PISA de 2015 – soit l’équivalent de deux années d’école – en compréhension de texte, mathématiques et sciences. Une différence additionnelle de 10 à 15 points était attribuée au fait d’être issu ou non de l’immigration, et de 24 à 31 points (soit un semestre d’écart) pour le fait de parler le luxembourgeois ou l’allemand à la maison, ou non. Un enfant ayant des parents immigrés avec un faible revenu et ne parlant aucune des trois langues du Grand-Duché sera ainsi triplement pénalisé.
Le système éducatif s’est flexibilisé, notamment pour mieux tenir compte de la grande diversité linguistique de la population. Sept écoles publiques internationales offrent un enseignement principalement en français, anglais ou allemand, certaines selon des cursus tels que les Écoles européennes ou le Cambridge International Curriculum. Et le programme « Zesumme Wuessen » actuellement testé dans quatre écoles fondamentales offre la possibilité d’alphabétiser un enfant en français plutôt qu’en allemand.
Des résultats encourageants
Selon le rapport, ces efforts paraissent prometteurs. Les écoles internationales affichent des résultats au moins aussi bons que celles qui suivent le programme standard et meilleurs en mathématiques. Cette situation est due au statut socioéconomique généralement élevé des parents scolarisant leur enfant dans ces structures, qui fait plus que compenser l’impact en général négatif d’un contexte migratoire.
Le programme « Zesumme Wuessen » n’a été lancé qu’à la rentrée 2023 et ne peut encore être rigoureusement évalué. Il montre néanmoins des signes prometteurs avec des meilleurs notes et plus grande motivation des élèves.
Les programmes préscolaires, tels que les foyers de jour ou les mini-crèches, ont un impact positif, quoique modeste comparé à l’influence du contexte familial, et devraient faire l’objet d’un suivi plus étroit. Le rapport révèle que les enfants ne parlant pas luxembourgeois ou allemand à la maison comprennent moins bien l’allemand au cycle 2, un signe que l’apprentissage du luxembourgeois au préscolaire ne suffit pas pour les préparer à l’allemand.
La langue influence les maths
Le rapport dément l’idée que les mathématiques sont indifférentes à la langue qu’on parle. Il souligne comment les handicaps posés par un niveau plus faible en allemand et par les changements de langue d’enseignement lors du parcours scolaire s’accumulent et produisent des différences marquées. On le voit par exemple chez les enfants parlant seulement le portugais à la maison (la communauté portugaise est le plus grand groupe d’origine étrangère, avec 13,5% de la population) : la différence de leurs résultats en mathématique avec les enfants parlant luxembourgeois, allemand ou français s’accroît de la première à la neuvième année. Deux tiers d’entre eux n’atteignent alors pas le niveau «socle», soit le niveau minimum attendu, contre un tiers pour ceux qui parlent l’une des trois langues d’enseignement.
Autre point révélé par le rapport : notre cerveau effectue des opérations sur les nombres de manière différente selon les langues, même dans notre langue maternelle. Cela s’explique notamment par l’énumération inversée en allemand et la formation hybride des nombres en français entre 70 et 99. L’influence marquée de la langue sur les résultats en mathématiques devrait être davantage considérée lors du dépistage de dyscalculie, qui tend actuellement à la diagnostiquer trop fréquemment chez les élèves allophones et trop rarement dans le groupe linguistique luxembourgeois-allemand.
Les résultats en mathématiques étant corrélés avec le succès professionnel futur, réduire ces différences jouerait un rôle important pour lutter contre les inégalités. Une piste serait de favoriser une acquisition plus complète de la langue d’instruction de mathématiques, et d’assurer la continuité de celle-ci en enseignant par exemple les mathématiques en français aux enfants alphabétisés dans cette langue.
Le multilinguisme a une image positive, mais peut constituer un obstacle en mathématiques lorsqu’un enfant doit passer d’une langue à l’autre. Parler plusieurs langues n’a pas la même signification pour un enfant exposé à au moins une des trois langues du Luxembourg à la maison que pour celui qu vit dans un ménage allophone : ce dernier sera confronté à des difficultés supplémentaires tout au long de son parcours scolaire.
Veux-tu lire le rapport en entier ? Le voici : Different schools for different pupils? What are the advantages and problems of Luxembourg's highly differentiated and stratified school system?, de Thomas Lenz et Christine Schiltz, Luxembourg, pour la Cellule scientifique de la Chambre des Députés, 17 mars 2025.



Le système scolaire au Luxembourg
Les enfants en dessous de 4 ans peuvent visiter des structures éducatives : foyers de jour, mini-crèches et l’enseignement précoce. Certaines de ces structures (notamment le précoce) aident les enfants allophones à apprendre le luxembourgeois.
L’école fondamentale obligatoire commence à 4 ans, en luxembourgeois. L’alphabétisation se fait normalement en allemand dès 6 ans, le français étant introduit au début à l’oral.
L’enseignement secondaire dès 12 ans se fait en allemand, à l’exception des mathématiques, en français.
Le français devient la langue d’enseignement dès 15 ans au lycée pour la voie classique menant au diplôme de fin d’études secondaires classiques. L’allemand reste la langue principale dans la voie générale, qui peut notamment mener à la formation professionnelle à partir de quinze ans.
En parallèle, des cursus internationaux offrent une éducation en allemand, français ou anglais.
Auteur : Daniel Saraga
Éditeur : Jean-Paul Bertemes (FNR)
Article basé sur le rapport de la cellule scientifique, rédigé par Christine Schiltz et Thomas Lenz de l’Université du Luxembourg