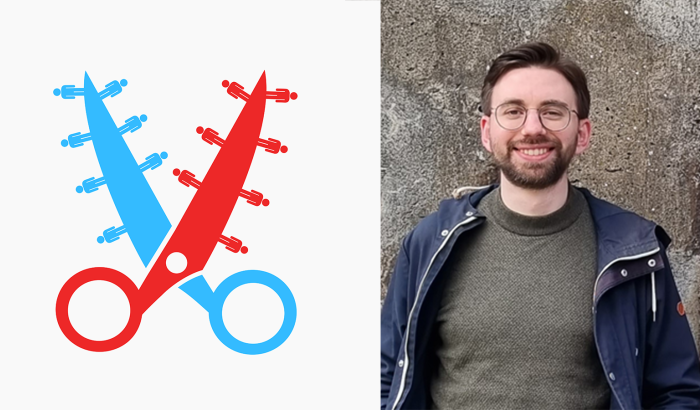Lors de la conférence « Research meets Politics », des chercheurs du LIST, du MNHN et de l'Université du Luxembourg ont présenté leur rapport sur l'impact de l'agriculture sur l'environnement.
Le but premier de l’agriculture est de produire de la nourriture destinée aux humains et à l’élevage. S’y ajoute la production de plantes ornementales, de fibres textiles ou encore de biogaz. Mais cette activité joue aussi un rôle essentiel pour préserver les écosystèmes et protéger la biodiversité. Les agriculteurs contribuent également à garantir de nombreux services écosystémiques, à savoir des processus naturels bénéfiques aux humains, comme la pollinisation, la purification de l’eau, la protection contre les inondations ou encore l’accès à des espaces de repos et de détente.
L’agriculture fait face à une triple crise environnementale : le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité et la pollution des sols et de l’eau. En même temps, le secteur contribue lui-même à cette crise par le rejet de gaz à effet de serre ainsi que par l’impact des monocultures et des produits phytosanitaires.
Un nouveau rapport rédigé pour la cellule scientifique de la Chambre des Députés examine les impacts environnementaux de l’agriculture et résume les défis d’une transition vers des pratiques durables. Il décrit des stratégies pour balancer croissance économique et protection de l’environnement, et analyse l’efficacité des mesures existantes. Il souligne que des pratiques agricoles plus durables sont essentielles pour protéger l’environnement, ralentir le changement climatique, assurer la production alimentaire et garantir la subsistance de l'agriculture. Cet article met en lumière quelques aspects importants du rapport.
Le rapport a été rédigé par les chercheurs Gitanjali Thakur (LIST), Axel Hochkirsch (MNHN) et Phillip Dale (Université du Luxembourg) ainsi que des membres de la cellule scientifique Maude Pauly et Christian Penny. Il a été présenté au public et aux parlementaires lors de la conférence « Research meets Politics » organisée par le FNR et la Chambre des Députés le lundi 24 mars.
Des initiatives pour une agriculture durable
Les espaces agricoles sont cruciaux pour environ la moitié de toutes les espèces animales et végétales d’Europe. Ces dernières se voient donc menacées autant par les impacts d’une agriculture intensive et des monocultures que par l'arrêt éventuel d'une exploitation. L’agriculture est de loin l’activité la plus gourmande en eau et contribue à la pollution des eaux de surface et souterraines, notamment par l’usage de fertilisants et de pesticides.
Réduire ces impacts passe par différentes approches. Le Luxembourg a mis en place des initiatives pour encourager des pratiques agricoles durables, comme la diversification et la rotation des cultures, la création de zones tampons ou encore la réduction de l’élevage bovin à impact environnemental élevé.
Pour évaluer l'efficacité des mesures prises, il faut disposer de données fiables sur l’évolution de la biodiversité et l’utilisation d’intrants (à savoir les pesticides, les engrais, les antibiotiques ou les semences commerciales), mais l’élaboration de statistiques crée une charge administrative supplémentaire pour les agriculteurs. Un point important est d’assurer la viabilité économique des exploitations agricoles, en favorisant des circuits de distribution courts et une consommation locale, ou en offrant des subventions aux exploitations qui prennent des mesures en faveur de la biodiversité.
Le rapport souligne que les actions menées, tant au Luxembourg que dans le cadre de la Politique agricole commune de l’UE – ont contribué à réduire les impacts sur le climat, la biodiversité et la qualité de l’eau, mais révèle que les progrès enregistrés sont à ce jour insuffisants.
Allier production alimentaire et énergétique
Les entreprises agricoles peuvent également contribuer à l’approvisionnement énergétique du pays, notamment en produisant du biogaz à partir de déchets. Ce procédé a l’avantage d'éviter que ces derniers ne laissent échapper du méthane, dont l’impact climatique est environ 25 fois plus grand que celui du CO2 produit par la combustion de biogaz. Une nouvelle piste est l’agrisolaire ou agrivoltaïque, à savoir l’installation de panneaux solaires sur des serres ou au-dessus de cultures. L’ombre produite par les panneaux peut réduire le rendement agricole, mais, étonnamment, elle peut aussi parfois l’augmenter légèrement. Cette approche génère une deuxième source de revenu pour l’exploitation agricole ou lui permet de réduire ses frais d’énergie. Au niveau national, elle peut contribuer à une plus grande indépendance énergétique.
Des innovations technologiques pourraient soutenir une agriculture de précision, par exemple grâce à des dispositifs robotisés pour détruire les mauvaises herbes ou la mise en œuvre d’autres types d’exploitations, telles que l’aquaponie ou les fermes verticales.
Un effort commun
Mettre en œuvre de telles innovations exige de travailler étroitement avec les agriculteurs, qui occupent une place centrale dans la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Il est également important d’impliquer les autres acteurs du domaine, des commerces d’alimentation au gouvernement, en passant par la société civile. Les consommateurs ont aussi un rôle clé à jouer, par exemple en optant pour des aliments dont la production nécessite moins d’énergie, d’eau et de surface agricole et rejette moins de gaz à effet de serre.
Voulez-vous lire le rapport en entier ? Le voici : Impact of agriculture on the environment and biodiversity in the context of Luxembourg – possible improvements for an economically viable and sustainable future, par P. Dale, A. Hochkirch, M. Pauly, C. Penny, G. Thakur, Luxembourg, pour la Cellule scientifique de la Chambre des Députés, 24 mars 2025.
Auteur : Daniel Saraga
Éditeur : Jean-Paul Bertemes (FNR)
Article basé sur le rapport de la cellule scientifique