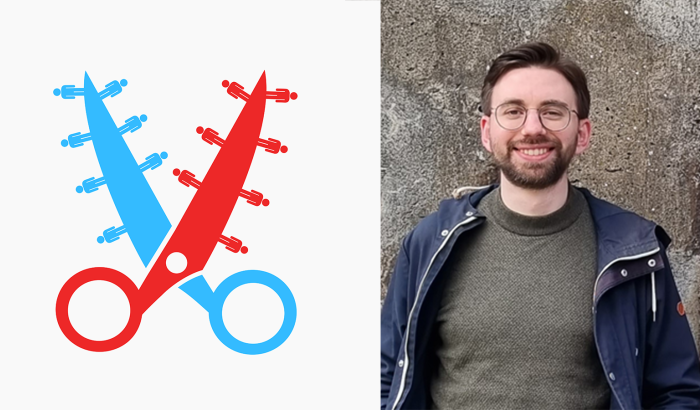L'économiste Anne-Catherine Guio du LISER a rédigé un rapport sur la pauvreté pour la cellule scientifique de la Chambre des Députés, présenté lors de la conférence « Research meets Politics ».
La pauvreté n’épargne guère le Luxembourg : elle y touche une personne sur cinq. Pour lutter contre la précarité, le gouvernement a développé toute une panoplie d’instruments pour aider les gens qui peinent à joindre les deux bouts.
Hélas, ces mesures ne profitent pas à tous ceux qui y auraient droit, et de loin : 75 % des ménages éligibles pour une subvention de loyer ne la touchent pas, tout comme 45 % des gens qui pourraient recevoir une allocation de vie chère. Un premier moyen de réduire la précarité est donc de s’assurer que les gens bénéficient vraiment des mesures qui leur sont destinées.
Un rapport demandé au LISER par la cellule scientifique de la Chambre des Députés a analysé les raisons de ce recours bien trop rare à l’aide sociale, et souligne un manque d’information ainsi qu’un certain découragement devant les démarches administratives. Il propose également des pistes pour combattre ce phénomène : informer la population de manière plus large et diversifiée, simplifier et uniformiser les procédures, et contacter de manière proactive les ménages qui pourraient bénéficier de soutiens.
Ce rapport rédigé par l’économiste Anne-Catherine Guio du centre de recherche LISER (Luxembourg Institute for Socio-Economic Research) a été présenté au public et aux parlementaires le lundi 24 mars lors de la conférence « Research meets Politics » organisée par le Luxembourg National Research Fund (FNR) et la Chambre des Députés à l’Abbaye de Neumünster. Nous présentons ici les messages clés du rapport.
Une quinzaine d’instruments existent
Les soutiens sont nombreux – une quinzaine – et vont de la prime énergie pour alléger les factures de chauffage à des subventions pour les frais scolaires. Plusieurs instruments peuvent compléter le revenu, comme le REVIS, l’AVC, la CIM ou encore la SMFR. Derrière chaque acronyme se trouve un instrument avec ses conditions d’éligibilité et méthodes de calcul propres. De quoi désorienter les gens qui pourraient en faire la demande.
Ces instruments ne sont pas tous bien connus de la population concernée. Les gens ont bien plus souvent connaissance de l’allocation de vie chère (AVC) que de la subvention de loyer ou que du crédit d’impôt monoparental (CIM). Il s’agit donc d’abord de mieux faire connaître ces possibilités de soutien, souligne le rapport. D’un côté, en passant par des canaux d’information diversifiés – des flyers aux réseaux sociaux et à la presse – et de l’autre en impliquant les acteurs sur le terrain, tels que les assistants sociaux, qui sont déjà en contact avec les gens en risque de pauvreté.
Alléger les procédures
Les processus administratifs peuvent décourager les personnes intéressées par une aide, montrent des entretiens réalisés par l’économiste. L’obligation de remplir chaque année un nouveau dossier – pourtant souvent identique aux années précédentes – est mal comprise, tout comme les longs délais pour être informé de l’avancée de son dossier ou pour recevoir la subvention ou encore le fait de se retrouver exclu d’un soutien mais pas d’un autre. Car les instruments utilisent différents seuils, eux-mêmes calculé de diverse manière à partir du revenu brut ou net, mensuel ou annuel.
Le rapport recommande d’uniformiser les critères d’octroi et de simplifier les démarches administratives, par exemple en préremplissant de manière automatique les formulaires à partir des données déjà en possession de l’administration. Un guichet unique centralisant les démarches et offrant une permanence téléphonique pour aider les gens à compléter leur dossier réduirait les barrières. Car de nombreuses demandes – un quart dans le cas de l’AVC et de la prime énergie – sont refusées en raison de dossiers incomplets ou transmis hors délai.
Réduire la stigmatisation
Les personnes interviewées par la chercheuse ont confié la gêne qu’elles ressentent à recourir à l’aide sociale malgré, par exemple, le fait d’avoir un emploi. Certaines se sont senties rabaissées de devoir détailler leurs dépenses alimentaires pour obtenir le droit de visiter des épiceries sociales, des institutions vendant à bas prix des denrées invendues. Un accès facilité, ou basé sur la confiance, pourrait alléger les procédures administratives actuelles. Un autre moyen pour réduire la stigmatisation et l’auto-censure serait d’utiliser un langage neutre, comme parler de «chèque» plutôt que de «soutien» et éviter des expressions telles que «pauvreté » ou «revenu faible». L’utilisation du «langage facile» avec des phrases courtes et des mots courants permettrait de réduire la barrière créée par une langue administrative complexe et difficile, et qui peut décourager les gens à aller jusqu’au bout de leur démarche.
Éviter l’effet de seuil - Ne pas pénaliser une augmentation de revenus
Le rapport suggère également de contacter directement les ménages susceptibles de bénéficier d’une aide, en se basant sur les données des années précédentes ou sur des informations fiscales, ou encore en encourageant les intermédiaires sociaux ou industriels à parler de manière proactive des instruments de soutien. Par exemple, un fournisseur d’énergie pourrait rappeler l’existence de la Prime énergie aux ménages qui ont payé plusieurs factures en retard, un signal qu’il y a peut-être des difficultés financières. Un calculateur en ligne unique indiquant tous les soutiens auxquels une personne a droit serait plus efficace que d’avoir, comme aujourd’hui, des outils différents pour les diverses aides.
Le rapport préconise d’introduire un seuil à plusieurs degrés avec des allocations partielles afin d’éviter l’effet de seuil, à savoir la perte d’une entière allocation dans le cas où le revenu d’une personne devait dépasser légèrement la limite. De même, la condition de résider au Luxembourg pendant cinq ans exclut une personne qui déménagerait temporairement en France ou en Belgique pour trouver un loyer modéré, alors même qu’elle continue de travailler au Luxembourg.
La pauvreté est un thème âprement débattu en politique. Mais ce rapport montre qu’on peut combattre la précarité en s’efforçant – à travers des mesures principalement administratives – que tous les gens touchent l’aide dont ils ont besoin et à laquelle ils ont droit.
Veux-tu lire le rapport en entier ? Le voici: Comment améliorer le recours aux aides sociales au Luxembourg ?, par Anne-Catherine Guio du LISER pour la Cellule scientifique de la Chambre des Députés, 18 mars 2025.



Les aides sociales au Luxembourg
Auteur : Daniel Saraga
Rédacteur : Jean-Paul Bertemes (FNR)
Article basé sur le rapport de la cellule scientifique, rédigé par Anne-Catherine Guio du LISER.