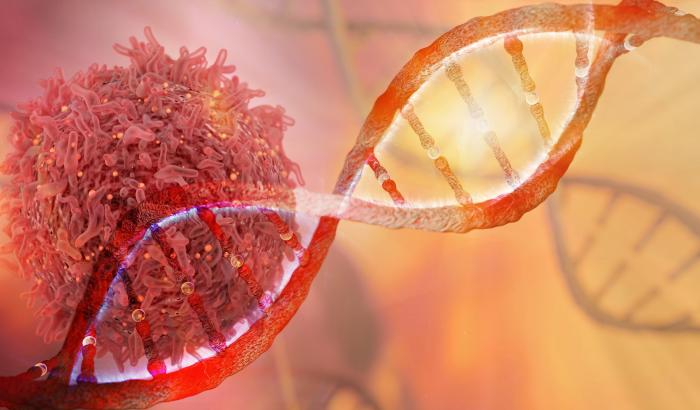CHL et AdobeStock/click_and_photo
Gauche : le Dr Carine De Beaufort, endocrinologue pédiatrique au CHL. Droite : un enfant atteint de diabète à qui on installe une pompe à insuline.
Le 14 novembre est la Journée mondiale du diabète. Cette année encore, l'Atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète (FID) livre des chiffres alarmants. Selon les estimations, en 2024, un adulte sur neuf dans le monde vivait avec un diabète et la majorité des personnes concernées présentait un diabète de type 2. Plus de 3,4 millions de personnes sont mortes des suites de cette maladie métabolique. Ces chiffres ne cessent d'augmenter et font du diabète l'un des enjeux de santé publique à la progression la plus rapide du siècle. Le Luxembourg ne fait pas figure d'exception. D'après les prévisions, le pays pourrait compter 44 000 cas de diabète d'ici 2050. Selon l'IDF, le Luxembourg fait déjà partie des cinq pays dont les dépenses de santé par personne liées au diabète sont les plus élevées au monde. Nous nous sommes entretenus avec le Prof. Carine De Beaufort, pédiatre à la KannerKlinik (CHL), experte en diabète et chercheuse, sur les thérapies actuelles et futures, le stress induit par la maladie et l'importance de l'activité physique et des fibres.
Infobox
Il y a un peu plus d'un siècle, des chercheurs ont découvert l'insuline, une hormone vitale produite par le pancréas. L'insuline régule la glycémie en acheminant le glucose (sucre) du sang vers les cellules du corps, où il peut être stocké ou utilisé comme énergie. Si l'insuline n'est pas présente en quantité suffisante ou si elle ne fonctionne pas de façon efficace, la glycémie augmente durablement. C'est ce qui se produit dans le diabète sucré (du latin « mellitus », « sucré comme le miel »), en raison d'un manque d'insuline ou d'une résistance à l'insuline. Il s'agit d'une maladie chronique qui nécessite généralement une attention et un traitement à vie.
Symptômes et risques : Parmi les symptômes typiques figurent une soif persistante, les mictions fréquentes, une perte de poids, la fatigue, les troubles visuels ou les infections. Cette maladie métabolique est chronique et, si elle n'est pas traitée, elle peut léser les vaisseaux sanguins et les organes, et entraîner des complications telles qu'un infarctus, une insuffisance rénale, une cécité ou une amputation des membres inférieurs.
Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune incurable dans laquelle le système immunitaire détruit les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Il se déclare souvent tôt chez les enfants et les jeunes adultes (de moins de 40 ans), et représente moins de 10 % de tous les cas de diabète. Les personnes concernées souffrent d'un véritable déficit d'insuline et doivent donc s'en injecter à vie. Au Luxembourg, près de 2 400 personnes sont concernées. Les causes exactes ne sont pas connues, mais la maladie résulte probablement d'une interaction entre une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux.
Dans le diabète de type 2, plus répandu, le métabolisme du sucre est perturbé. Les cellules des muscles, du tissu adipeux et du foie réagissent moins sensiblement à l'insuline. En raison de cette diminution de la réactivité, de plus en plus d'insuline doit être sécrétée, jusqu'à ce que les cellules bêta soient épuisées. Cette forme de diabète représente près de 90 % de tous les cas et est souvent favorisée par le surpoids, un excès de graisse abdominale, un manque d'activité physique et une alimentation déséquilibrée. Parmi les autres facteurs de risque figurent l'hypertension artérielle et la présence de cas de diabète de type 2 dans la famille proche.
Le diabète de type 2 peut passer inaperçu pendant des années avant que des complications apparaissent. D'après la Fédération internationale du diabète (FID), quatre personnes sur dix ignorent qu'elles sont atteintes de la maladie. Le Luxembourg compte plus de 30 000 personnes atteintes de diabète de type 2, dont de plus en plus d'enfants et d'adolescents. Le traitement repose sur une alimentation saine, l'exercice d'une activité physique régulière, la prise de médicaments et, si nécessaire, l'administration d'insuline. Avec un changement rigoureux du mode de vie, la glycémie peut se stabiliser, mais la prédisposition et le risque de rechute demeurent. Même si de plus en plus d'enfants et de jeunes développent un diabète de type 2, le risque de maladie augmente avec l'âge (à partir de 45 ans environ). Testez votre risque de développer un diabète de type 2 sur le site Internet du ministère de la Santé.
Il existe en outre d'autres formes très rares de diabète, qui sont déclenchées par des défauts génétiques ou d'autres maladies et sont souvent désignées comme diabète de type 3. En outre, un diabète peut apparaître chez la future mère au cours de la grossesse (diabète gestationnel).
Le nombre de cas de diabète augmente à l'échelle mondiale. Qu'observez-vous au Luxembourg ?
Carine De Beaufort : Quand j'ai commencé à exercer à la KannerKlinik en 1987, je voyais près de neuf nouveaux cas par an d'enfants âgés de 0 à 14 ans atteints de diabète de type 1. Aujourd'hui, on compte 35 nouveaux cas détectés dans la tranche d'âge allant de 0 à 18 ans, et les chiffres augmentent chaque année de deux à trois pour cent Le diabète de type 2 se développe lentement et touche surtout les adultes, mais nous voyons aujourd'hui aussi des enfants et des adolescents atteints de diabète de type 2 chez qui la maladie se manifeste souvent de façon nettement plus agressive. Le diabète de type 2 continue de progresser en raison du nombre croissant de personnes en surpoids, tant dans les pays industrialisés que dans les pays plus pauvres. Aujourd'hui, le diabète fait partie des dix maladies avec le taux de létalité le plus élevé.
Quelles fausses idées sur le diabète observez-vous, tant dans votre pratique quotidienne que dans l'opinion publique ?
On confond souvent le diabète de type 1 et le diabète de type 2, bien que leurs causes soient très distinctes. Le type 1 est d'origine auto-immune : le corps ne produit plus d'insuline. Le type 2 est d'origine métabolique et s'accompagne d'une résistance à l'insuline (acquise). Certaines personnes pensent, à tort, que le diabète est contagieux. D'autres croient à des traitements miraculeux proposés par des centres douteux. Beaucoup de gens sous-estiment les risques à long terme du diabète, comme l'infarctus ou la cécité. Mais surtout, les personnes en bonne santé peinant à imaginer la charge psychologique que représente le diabète pour les personnes concernées.
Il n'est pas facile de vivre avec un diabète de type 1, car cette maladie exige énormément de discipline. Il faut surveiller en permanence ce que l'on mange et les quantités ingérées, calculer l'insuline nécessaire et se l'administrer soi-même pour maintenir l'équilibre glycémique et éviter les symptômes. Les personnes atteintes de diabète de type 1 n'ont jamais de répit par rapport à leur maladie. Si elles ne pensent pas à leur maladie, la maladie pense à eux. C'est un grand fardeau. Le soutien psychologique représente donc une composante essentielle de la thérapie, surtout pour les enfants.
Stress lié à la gestion du diabète
Des chercheurs d'instituts de recherche luxembourgeois et de la KannerKlinik mènent plusieurs projets pour déterminer comment des solutions innovantes peuvent contribuer à réduire le stress lié à la gestion du diabète. Ainsi, selon une étude de la KannerKlinik et du LUCET de l'Université du Luxembourg, le personnel soignant a observé une meilleure qualité de vie chez les jeunes enfants lorsqu'ils utilisaient des systèmes automatiques d'administration d'insuline associant un capteur de glucose, une pompe à insuline et un algorithme qui calcule le dosage d'insuline. Dans le cadre d'un autre projet, des chercheurs du Luxembourg Institute of Health (LIH) testent des interventions numériques destinées à améliorer la gestion du diabète et capables de détecter le stress des personnes diabétiques à leur voix. L'objectif est de développer un dispositif de surveillance à distance capable d'évaluer le bien-être psychologique d'un patient.
Quelles sont à l'heure actuelle les options thérapeutiques les plus efficaces pour contrôler le diabète ?
Le diabète de type 1 comme celui de type 2 ne sont pas des maladies simples à traiter. Plus de cent ans après la découverte de l'insuline, la thérapie par insuline, combinée à l'autogestion et à une hygiène de vie saine, reste la pierre angulaire de la prise en charge du diabète de type 1. La piqûre classique à faire dans le doigt pour mesurer la glycémie et la seringue d'insuline ou le stylo injecteur à enfoncer dans la graisse abdominale existent certes toujours. Mais la technologie a beaucoup progressé, et l'administration d'insuline est devenue bien plus facile.
Beaucoup de gens atteints de diabète peuvent aujourd'hui mesurer leur glycémie grâce à de petits capteurs placés sur la peau. Les systèmes automatiques de dosage d'insuline combinent ce dispositif de mesure continue du glucose avec une pompe qui délivre l'insuline dans la graisse sous-cutanée par l'intermédiaire d'un cathéter. Le capteur et la pompe communiquent entre eux grâce à l'intelligence artificielle, un peu comme un pancréas artificiel. Les valeurs sont affichées à l'aide d'une application sur la pompe ou le smartphone. L'algorithme détermine la quantité d'insuline nécessaire et corrige les fluctuations de glycémie, si bien que la personne concernée peut dormir en toute tranquillité. Il s'agit là d'un progrès immense.
Malheureusement, tous les diabétiques dans le monde n'ont pas accès à ces technologies, que ce soit pour des raisons financières ou d'éligibilité personnelle. Au Luxembourg, les technologies médicales les plus avancées sont heureusement disponibles. La KannerKlinik compte parmi les premiers établissements à avoir employé ces systèmes automatiques chez les enfants, et les utilise avec succès. Les enfants en particulier adorent cette thérapie via application et sont très motivés. Le système fonctionne tellement bien qu'ils doivent généralement se rendre moins souvent aux contrôles et que la vie familiale en devient plus simple.
La mesure la plus efficace pour lutter contre le diabète de type 2 reste incontestablement un mode de vie sain. Je ne peux pas le répéter assez souvent.
Dr. Carine de Beaufort
Quel rôle joue la consommation de sucre ?
Le diabète de type 1 est provoqué par un déficit d'insuline dû à une maladie auto-immune dans laquelle le sucre ne joue pas de rôle direct. La situation est différente en ce qui concerne le développement du diabète de type 2. En effet, les personnes qui consomment trop de produits sucrés, comme des bonbons, des sodas ou des plats industriels, s'exposent au risque de surpoids et à une élévation durable de la glycémie et de l'insulinémie. Cela peut rendre les cellules du corps résistantes à l'insuline, solliciter excessivement le pancréas et entraîner un diabète de type 2.
Existe-t-il des stratégies ou des médicaments non basés sur l'insuline qui s'avèrent prometteurs ?
Pour le diabète de type 2, neuf adultes sur dix reçoivent des médicaments qui régulent la glycémie à l'issue de leur diagnostic. Une adaptation stricte du mode de vie peut réduire leur besoin en médicaments. La stratégie la plus prometteuse contre le diabète de type 2 reste incontestablement un mode de vie sain associé à une activité physique régulière. Je ne le répéterai jamais assez. Nos gènes ne se sont pas encore adaptés à la société d'abondance. Avec une offre alimentaire excessive et trop pauvre en fibres, nous prenons du poids sans le vouloir.
Et le surpoids constitue un facteur de risque majeur dans le diabète de type 2. Certaines personnes peuvent aussi envisager une chirurgie bariatrique. Pour toutes les personnes atteintes de diabète, le traitement repose sur une combinaison de médicaments adaptée individuellement afin de stabiliser la glycémie. Si cela ne suffit pas, il faut recourir à l'insuline.
Qu'en est-il des « piqûres amaigrissantes » comme l'Ozempic ?
Les piqûres amaigrissantes proposées par divers fabricants représentent en effet une piste prometteuse pour aider les personnes atteintes d'un diabète de type 2 à réduire leur surpoids et à améliorer leur métabolisme du sucre. La dernière génération de ces médicaments existe même déjà sous la forme de comprimés. Chez certains adolescents, les médicaments amaigrissants semblent malheureusement présenter une efficacité légèrement réduite. Il est important que les utilisateurs maintiennent une activité sportive et ne perdent pas de masse musculaire.
L'Ozempic – la piqûre amaigrissante
L'Ozempic, aussi appelé « piqûre amaigrissante », a été initialement conçu pour traiter le diabète de type 2 et n'est actuellement autorisé au Luxembourg que pour cette indication. L'Ozempic a divers modes d'action :
- Le principe actif de l'Ozempic est le sémaglutide. Le sémaglutide imite une hormone appelée GLP-1, qui régule la libération d'insuline chez les personnes en bonne santé. Chez les personnes diabétiques, cette libération ne se fait plus correctement. L'Ozempic, ou le sémaglutide, stimule le pancréas afin qu'il libère davantage d'insuline après les repas, au moment où elle est censée faire baisser la glycémie.
- Le sémaglutide aide par ailleurs à réduire la production de glucagon, une hormone qui incite le foie à libérer du glucose (sucre), ce qui contribue aussi à abaisser la glycémie.
- Le médicament ralentit par ailleurs le passage des aliments de l'estomac dans l'intestin grêle. Cela contribue aussi à stabiliser la glycémie après le repas. En outre, il crée une sensation de satiété prolongée, ce qui fait que, même sans être diabétique, on a moins faim et on mange moins. C'est pour cette raison que le médicament est aussi utilisé par des personnes non diabétiques, ce qui a entraîné des pénuries. Pour les personnes en surpoids, il existe le Wegovy, une injection qui contient le même principe actif que l'Ozempic.
L'Ozempic s'injecte une fois par semaine. Comme tout médicament, l'Ozempic a aussi des effets secondaires. Il est donc essentiel d'en discuter avec son médecin afin de déterminer si l'Ozempic convient pour le traitement.
Quelles sont à ce jour les avancées les plus remarquables dans la recherche sur le diabète ?
Dans le cas du diabète de type 1, beaucoup de projets de recherche portent sur la détection précoce de la maladie, avant l'apparition de symptômes cliniques et de graves troubles métaboliques. L'objectif est d'arrêter ou de retarder la réaction auto-immune – et donc la destruction des cellules bêta productrices d'insuline dans le pancréas. Cette destruction est déclenchée par des auto-anticorps qui sont fabriqués par le corps et dirigés contre les cellules bêta. Ces auto-anticorps peuvent souvent être détectés des années avant qu'un diabète de type 1 se déclare. Il existe en Europe plusieurs programmes de dépistage qui testent déjà la population pour déceler des maladies auto-immunes et des auto-anticorps.
De grands espoirs sont placés dans des médicaments capables d'influencer le système immunitaire et d'atténuer les attaques auto-immunes. Le vérapamil, un médicament pour le cœur, est considéré comme prometteur, car il est capable de protéger les cellules bêta chez les personnes atteintes de diabète de type 1. Des études américaines ont démontré son efficacité. Le teplizumab, un immunomodulateur, est déjà approuvé aux États-Unis pour repousser d'environ deux ans la manifestation clinique du diabète de type 1 chez certains patients au stade 2. En Europe, une demande d'autorisation a été déposée.
Au moins dix autres médicaments sont en cours d'étude pour freiner la progression du stade 2 au stade clinique 3 du diabète de type 1 Des vaccins sont aussi en cours de développement pour rendre le système immunitaire « tolérant » aux attaques immunitaires dirigées contre les cellules bêta. Rendre le système immunitaire tolérant signifie que le corps n'identifie plus ses propres cellules bêta comme dangereuses et cesse d'essayer de les détruire.
Où en est la thérapie par cellules souches ?
La thérapie par cellules souches pourrait rendre possible une guérison complète sans administration d'insuline à vie. Le procédé consiste à cultiver en laboratoire des cellules bêta à partir de cellules souches de donneurs et à les implanter chez le patient. De nouvelles cellules productrices d'insuline peuvent ainsi se former. Les premières études menées en Chine et aux États-Unis ont montré qu'avec ce procédé, les patients récupèrent partiellement leur capacité à produire de l'insuline. Mais l'un des principaux enjeux est que le corps peut rejeter les cellules implantées et nécessite un traitement immunosuppresseur à vie – c'est-à-dire des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire et rendent, par exemple, les patients plus vulnérables aux infections.
Une étude suédo-américaine publiée récemment propose une méthode qui permet d'introduire des cellules souches directement dans le corps, ce qui est censé éliminer la nécessité de prendre des immunosuppresseurs. Lors de cette toute première transplantation de cellules d'îlots pancréatiques génétiquement modifiées, un patient a retrouvé la capacité de produire naturellement de l'insuline sans provoquer de rejet. Même si ces travaux en sont encore au stade expérimental, ils montrent que les thérapies par cellules souches constituent une piste prometteuse pour le diabète de type 1. J'ai bon espoir que cette thérapie finira par voir le jour.
Et quelles sont les perspectives pour le diabète de type 2, beaucoup plus fréquent ?
En plus des piqûres et comprimés de nouvelle génération destinés à la perte de poids, d'autres médicaments mieux tolérés sont en cours de développement. Par ailleurs, le microbiome intestinal – c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes présents dans l'intestin – attire de plus en plus l'attention des chercheurs, non seulement pour le diabète de type 1, mais aussi pour le diabète de type 2. Dans les premières années de vie, le microbiome influence la maturation du système immunitaire – et donc probablement le risque de développer des maladies auto-immunes – et, plus tard, le métabolisme et la sensibilité à l'insuline.
Les personnes atteintes de diabète de type 2 présentent souvent un microbiome modifié et moins diversifié. Dans ce cas, une alimentation riche en fibres contribue à favoriser la prolifération des « bonnes » bactéries qui améliorent le métabolisme du glucose. Dans une étude qui a été menée à Amsterdam et qui utilise des transplantations de selles de donneurs sains, des adultes atteints de diabète de type 2 sont redevenus, du moins temporairement, plus sensibles à l'insuline. La recherche a toutefois besoin d'urgence de données comparables au niveau mondial pour pouvoir évaluer les résultats avec plus de précision.
Est-ce aussi le cas du Luxembourg ?
Au Luxembourg, nous avons besoin d'un registre du diabète qui recense tous les patients et non pas seulement les enfants, pour que nous puissions déterminer les traitements et les technologies qui sont efficaces à long terme. L'augmentation du nombre de maladies non transmissibles, comme le diabète de type 1, l'obésité et les allergies chez les enfants, suggère que des facteurs environnementaux, éventuellement transmis par le microbiome, jouent un rôle central. C'est pourquoi la recherche menée sur les premières phases de la vie constitue une priorité pour assurer la santé des futures générations.
Notre principal objectif est d'améliorer la qualité de vie des enfants atteints de diabète et de leurs familles grâce à des technologies innovantes et à une meilleure compréhension des causes du diabète. Un tel travail n'est possible qu'en collaborant avec des organismes nationaux, tels que le LCSB, le LIH, les équipes de la KannerKlinik et divers partenaires internationaux.
Il serait aussi important d'évaluer de façon précise le risque de diabète de type 2 chez tous les jeunes en surpoids. Sans une approche scientifique fondée sur des données concrètes, nous ne pouvons ni confirmer nos observations ni évaluer les tendances ou la mortalité. Mais tous ces éléments peuvent jouer un rôle déterminant dans l'élaboration des politiques de santé et des futures approches thérapeutiques.
Qu'il s'agisse de bannir certains produits qui contiennent trop de sucre ou de taxer ceux qui sont particulièrement mauvais pour la santé, les possibilités sont multiples. En dix jours seulement, le corps s'adapte à une alimentation moins sucrée.
Dr. Carine de Beaufort
Le diabète de type 2 est de loin la forme la plus courante de la maladie et touche aussi de plus en plus de jeunes. Que fait-on pour prévenir la maladie ?
En dépit de vastes campagnes publiques comme « Gesond iessen, méi bewegen » et de la collaboration des hôpitaux et des chercheurs avec la médecine scolaire, force est de constater que ces efforts restent insuffisants. En tant que société, nous devons accorder beaucoup plus d'attention à la santé des enfants, car les cellules adipeuses se développent dès la petite enfance. Le rôle essentiel d'une activité physique régulière est toujours sous-estimé. Des études comparatives menées dans des crèches ont clairement montré que 30 minutes d'activité par jour contribuent à réduire le BMI et donc les risques d'obésité et de diabète de type 2 plus tard. Mais quand les deux parents travaillent à temps plein et que les familles manquent de temps pour préparer à manger ou pratiquer une activité physique, nous sommes confrontés à un véritable problème sociétal.
À ce jour, aucun pays européen ne dispose de « meilleures pratiques » en matière d'éducation alimentaire pour instaurer durablement de bonnes habitudes alimentaires chez les jeunes générations. Qu'il s'agisse de bannir certains produits qui contiennent beaucoup de sucre, comme l'avait proposé l'ancien ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo, ou de taxer ceux qui sont particulièrement mauvais pour la santé, les possibilités sont multiples. L'important est de mobiliser la famille tout entière, mais aussi les établissements scolaires. Non pas en envoyant une fois par an un grand chef cuisinier dans les classes, mais en augmentant durablement la teneur en fibres des menus dans les cantines scolaires. En dix jours seulement, le corps s'adapte à une alimentation moins sucrée.
Auteure : Britta Schlüter
Édition : Michèle Weber (FNR)
Traduction : Nadia Taouil (www.t9n.lu)