
AdobeStock/Jesse B/peopleimages.com
Les résultats de sondages servent de base aux décisions, aux choix faits lors de la planification et aux prévisions, que ce soit dans les domaines politique, économique ou social.
Les enquêtes, les données et les statistiques sont des ressources précieuses. Elles servent de base aux décisions, aux choix faits lors de la planification et aux prévisions, que ce soit dans les domaines politique, économique ou social. Qu'est-ce qui fait qu'une enquête est crédible ? Et pourquoi est-il si important de participer aux enquêtes des instituts de recherche publics au Luxembourg ? À l'occasion de la Journée mondiale de la statistique, nous avons abordé ces sujets avec deux experts de la Société luxembourgeoise de Statistique, à savoir Guillaume Osier, chef du département « Conditions de vie » au STATEC, et Gwenaëlle Le Coroller, biostatisticienne au Centre de compétence en méthodologie et statistique du Luxembourg Institute of Health (LIH).
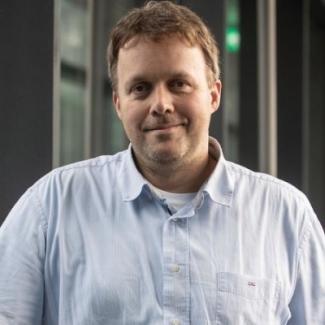

À gauche: Guillaume Osier (STATEC); à droite: Gwenaëlle Le Coroller (LIH)
En tant que citoyen, on a parfois l'impression d'être de plus en plus souvent sollicité pour participer à des enquêtes. Est-ce vrai ?
Guillaume Osier (G.O.) : Oui, le nombre d'enquêtes a nettement augmenté au cours des dernières décennies en raison d'un besoin croissant de données et d'informations factuelles. Le STATEC à lui seul réalise près de 15 enquêtes par an auprès de particuliers et plus de 30 auprès d'entreprises, en partie avec l'aide d'instituts d'enquête privés. Sur le plan historique, les enquêtes représentent une approche relativement récente dans les domaines de la recherche sociale et de la statistique. Ce n'est que dans le contexte de la croissance économique qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale que l'on a commencé en Europe à recueillir et analyser à l'aide d'enquêtes des données économiques qui ne pouvaient pas être expliquées par des sources traditionnelles, comme les recensements – par exemple en ce qui concerne les comportements d'achat et de consommation des citoyens. En effet, dans les enquêtes, les participants fournissent aussi des informations sur leur propre comportement et leurs perceptions. Elles sont indispensables pour comprendre les raisonnements ou les actions des gens. Cette méthode apporte donc une réelle valeur ajoutée par rapport aux informations qui découlent des données administratives. Les enquêtes sont menées par des organismes publics comme le STATEC, par des instituts de recherche et des universités, mais aussi par des bureaux d'étude de marché privés pour le compte de leurs clients. J'estime qu'après la forte augmentation du nombre d'enquêtes, nous avons maintenant atteint un pic.
Sur quels sujets recueille-t-on des informations au moyen d'enquêtes au Luxembourg ?
G.O. : Dans le domaine des statistiques sociales, le STATEC mène des enquêtes auprès de la population générale sur les revenus et les conditions de vie, ainsi que sur des questions qui sont au centre du débat public au Luxembourg, telles que la situation du marché du logement ou l'enseignement des langues étrangères. Dans le domaine de l'économie, les experts en économie et les décideurs sont interrogés sur des sujets comme les salaires, le coût de la main-d'œuvre, les investissements ou la productivité. Une grande partie des demandes émanent d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Dans ce contexte, le Luxembourg, à l'instar des autres États membres, doit fournir des données nationales afin de permettre les comparaisons entre pays.
Gwenaëlle Le Coroller (G.L.C.) : Les enquêtes jouent aussi un rôle central quand il s'agit de recueillir des informations sur la santé de la population résidente. Une enquête sur la santé des citoyens menée à l'échelle de l'UE est actuellement en cours. Elle porte sur les maladies, les accidents, les problèmes de santé, la participation aux programmes de dépistage précoce, les séjours à l'hôpital, la consommation de médicaments, la consommation de drogues, l'alimentation, l'activité physique et les appréciations personnelles. La personne interrogée considère-t-elle sa santé comme excellente, bonne, moyenne, mauvaise ou très mauvaise ?
Seule une enquête, et non pas une base de données, peut offrir un feedback individuel de ce type. L'objectif est d'élaborer une cartographie des comportements de santé. Elle fournit des informations sur la prévalence de certaines maladies, sur la couverture vaccinale et sur le mode de vie des citoyens. Et, grâce à ces données mesurables, elle offre une base objective pour la prise de décision et des éléments pour l'élaboration de prévisions. Ces données permettent au gouvernement et aux autorités d'évaluer la nécessité de mettre en place des campagnes de dépistage, de prévention ou de sensibilisation.
Trouvez-vous encore suffisamment de participants ou la population éprouve-t-elle une certaine lassitude face aux enquêtes ?
G.O. : En vertu de la loi, les citoyens sont tenus de participer aux enquêtes menées par le STATEC ou pour le compte du STATEC (voir encadré). Comme la population du Luxembourg est petite, la probabilité d'être contacté par un institut d'enquête est élevée. On observe donc un risque croissant d'une certaine lassitude face aux enquêtes. Ce phénomène concerne particulièrement certains groupes cibles, dont les jeunes. C'est pourquoi nous essayons de mieux organiser les enquêtes pour que certaines questions ne soient pas posées plusieurs fois et que les citoyens ne soient pas sollicités trop souvent. Il est important de prendre conscience de l'importance de la participation : les statistiques reposent entièrement sur la participation de l'ensemble des citoyens. Nous avons besoin d'un maximum de réponses. C'est la seule manière d'obtenir des données fiables.
G.L.C. : Dans le domaine de la santé en particulier, il existe d'autres enquêtes et études de recherche qui n'ont pas de caractère obligatoire, mais qui reposent tout de même sur la participation de la population. Il est important d'expliquer clairement l'objectif de ces études pour éviter la lassitude des participants, de veiller à ce que l'attention soit portée sur le groupe cible et d'éviter de solliciter tout le temps les mêmes personnes.
La participation aux enquêtes du STATEC relève-t-elle d'un devoir civique ?
Vous avez reçu un courrier de l'Institut national de la statistique et des études économiques, mieux connu sous le nom de STATEC ? De la même manière qu'il existe une obligation de vote, les citoyens sont tenus de participer aux enquêtes du STATEC. Selon l'article 13 de la loi portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques, toute personne invitée à participer à une enquête est tenue de le faire. Cette obligation concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, les administrations publiques, les communes et les établissements publics. Seules les enquêtes clairement identifiées comme « facultatives » font exception. Avec cette obligation de participation, le législateur souhaite garantir qu'un nombre suffisant de personnes prenne part aux enquêtes et assurer la représentativité et la fiabilité des résultats. La loi prévoit des amendes en cas de refus de participation ou si les participants donnent des réponses erronées. Dans les faits, les particuliers ne reçoivent généralement qu'un avertissement ou un rappel.
Les statistiques reposent sur la participation de l'ensemble des citoyens.
Guillaume Osier
Les gens sont-ils agacés par les enquêtes ou y a-t-il d'autres raisons ?
G.L.C. : La lassitude face aux enquêtes s'explique d'un côté par le nombre élevé d'enquêtes et de l'autre par les inquiétudes liées à la protection des données. Les gens peinent souvent à comprendre pourquoi, dans une enquête sur les comportements de santé, ils doivent aussi fournir des informations sur le ménage, comme le revenu annuel ou la profession, et s'interrogent sur l'utilisation de ces informations. Je peux vous assurer : les questions ont toujours un lien direct avec l'objectif de l'enquête. La santé est étroitement liée à des facteurs socioéconomiques tels que le revenu, l'éducation et la profession. Sans ces informations, il serait impossible de mesurer les inégalités et d'identifier les groupes particulièrement affectés par certaines maladies ou certains comportements à risque.
La santé est étroitement liée au revenu, à l'éducation et à la profession. Ces informations sont indispensables pour mesurer les inégalités.
Gwenaëlle Le Coroller
G.O. : Tous les citoyens ne connaissent pas les missions de l'institut de statistique (voir encadré « Qu'est-ce que le STATEC ? »). Certains nous confondent avec l'administration des contributions et craignent un contrôle d'impôts quand ils indiquent leur revenu annuel. Or, il est interdit d'établir un lien entre les données d'enquête et les données fiscales. Au Luxembourg, les enquêtes et les études sont soumises à la loi sur la protection des données. Avec la Commission nationale pour la protection des données (CNPD), nous disposons des structures de contrôle nécessaires. Les données recueillies par le STATEC ou d'autres instituts de recherche publics sont uniquement utilisées à des fins de recherche, de politique économique ou de santé, ou pour d'autres objectifs publics. Elles ne sont ni vendues ni utilisées à d'autres fins commerciales. Nous ne distribuons pas non plus de bons d'achat ni d'autres incitations à la participation.
Pouvez-vous citer des enquêtes qui ont profité aux citoyens ?
G.O. : Prenons l'exemple de l'index, l'indexation automatique des salaires et traitements. L'index repose sur les prix à la consommation, qui sont déterminés à l'aide de plusieurs sources, dont les enquêtes auprès des ménages. La collecte de données sur les dépenses des citoyens permet de pondérer correctement des postes tels que l'alimentation, le transport ou les loisirs dans le panier de la ménagère lors du calcul de l'index. Les autres États membres de l'UE mènent des enquêtes similaires.
Un autre exemple concerne nos enquêtes sur les revenus et les conditions de vie des ménages au Luxembourg. Selon ces enquêtes, quelque 120 000 personnes, soit 18,8 % de la population, sont touchées par la pauvreté. Ces chiffres servent de base à la politique du ministère de la Famille en matière de lutte contre la pauvreté. Un plan d'action est en cours d'élaboration et un grand nombre de mesures prévues s'appuient sur les résultats des enquêtes. Ils fournissent des éléments de preuve basés sur des données qui aident les responsables politiques à prendre des décisions.
G.L.C. : Les données issues de l'enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) servent par exemple de base à la Direction de la Santé luxembourgeoise pour des campagnes visant à sensibiliser les citoyens à une alimentation plus saine, à une pratique physique plus régulière et à la lutte contre l'obésité afin de prévenir les maladies cardiovasculaires. L'année dernière, le « Bus du Cœur des femmes » s'est arrêté au Luxembourg pour offrir à des femmes en situation précaire des examens gratuits de dépistage cardiovasculaire et gynécologique. Des campagnes d'information sur la consommation d'alcool et de tabac ont également été menées, comme l'initiative « Zéro alcool » ou le « No smoking challenge ».
Ou prenez l'enquête sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans le domaine de la santé menée en 2024 par le LIH en collaboration avec le ministère de l'Égalité des genres et de la Diversité. De nombreux indicateurs révèlent des différences claires entre les femmes et les hommes, à savoir les comportements alimentaires, le nombre de visites médicales, la consommation d'alcool et de cigarettes, les accidents du travail, les violences domestiques, les maladies, l'espérance de vie et les causes de décès. Les caractéristiques de la santé et du comportement des femmes et des hommes examinées dans cette étude sont prises en compte dans ces mesures de prévention et les soins de santé.
Il faut toutefois faire la distinction entre les enquêtes et les études scientifiques. Au LIH, nous menons des études scientifiques. Elles sont soumises à des règles spécifiques en matière de protection des données et doivent être approuvées par le Comité national d'Éthique de Recherche (CNER). Et leurs résultats sont principalement publiés dans des publications de recherche difficilement accessibles pour le grand public.
En règle générale, combien faut-il de participants pour qu'une enquête soit représentative ?
G.L.C. : En raison de l'investissement conséquent en termes de travail et de temps que demanderait une enquête auprès de l'ensemble de la population, on constitue un échantillon représentatif des habitants qui reflète correctement la proportion des différents groupes, par exemple celle des jeunes. La taille des échantillons varie selon l'objectif, le public cible et la précision requise de l'enquête, et est comprise entre quelques centaines et plusieurs milliers de personnes. En particulier dans les enquêtes de petite envergure qui s'adressent à un groupe cible très spécifique, par exemple les patients masculins atteints de la maladie de Parkinson âgés de plus de 45 ans, chaque voix compte. En effet, ce groupe cible représente une minorité et s'il souhaite se faire entendre, il doit s'exprimer.
Quand une enquête est-elle considérée comme « représentative » ?
G.O. : On peut sélectionner délibérément les personnes qui constituent l'échantillon en fonction de l'objectif de l'enquête et interroger un groupe comprimé de la population répondant aux critères typiques, comme la taille des groupes d'âge, les sexes ou la distribution de la population par région. C'est la méthode la plus connue. Elle a l'inconvénient de ne fonctionner que pour un objectif déterminé.
Une alternative consiste à sélectionner les participants qui constituent l'échantillon selon le principe du hasard. C'est la méthode qu'utilise le STATEC : un algorithme sélectionne aléatoirement des personnes dans le registre national des personnes physiques. Le hasard est le critère de sélection le plus objectif. Si le hasard n'intervenait pas, une ou plusieurs opinions pourraient être favorisées. Un échantillon aléatoire est, par nature, représentatif et reflète les structures de la population, à condition qu'il soit suffisamment grand. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. L'approche est indépendante de l'objectif de l'enquête. De plus, cette méthode permet de calculer plus précisément les incertitudes statistiques ou les marges d'erreur.
Les enquêtes sont-elles toujours menées en personne ou par téléphone, ou surtout en ligne ?
G.O. : Les méthodes ont beaucoup évolué. Les enquêtes sur papier menées par un enquêteur qui se rend au domicile des personnes sont devenues rares. De nos jours, les enquêtes se font de plus en plus souvent en ligne. On peut répondre au questionnaire à l'ordinateur ou à l'aide de son smartphone. Les personnes âgées préfèrent le téléphone ou le papier, tandis que les jeunes privilégient les enquêtes en ligne. Au STATEC, nous appliquons une méthode multimodale qui combine les enquêtes en ligne et par téléphone, l'Internet dominant clairement avec plus de 80 %.
La méthode a-t-elle une influence sur le résultat ?
G.L.C. : Absolument. Les participants aux enquêtes en ligne se montrent souvent moins attentifs et y consacrent moins de temps. Ils ne lisent pas l'ensemble du texte, ne répondent qu'à la première moitié des questions ou cliquent seulement sur les trois premières réponses parmi dix. Le risque de recueillir des données vagues augmente. Sur un support papier, les participants lisent les questions à tête reposée. De plus, les personnes âgées répondent plus volontiers aux questionnaires au format papier, car elles maîtrisent moins bien Internet. Selon la méthode utilisée, on atteint donc différents groupes cibles.
G.O. : Les enquêtes multimodales reflètent mieux la population, mais fournissent des données moins précises. D'un autre côté, les enquêtes par téléphone ou en personne peuvent aussi entraîner des biais. Au téléphone, on se souvient avant tout des trois dernières réponses possibles. Et lors des entretiens en personne, les gens répondent différemment selon la personne qu'ils ont en face d'eux. Ou ils ne répondent pas honnêtement et préfèrent donner la réponse considérée comme socialement souhaitable. C'est ce que nous appelons le biais de désirabilité. On affirme par exemple à l'enquêteur qu'on fait du sport tous les jours, alors que ce n'est pas le cas.
Comment gérez-vous ces incertitudes et d'autres incertitudes statistiques ?
G.O. : Il n'existe pas de remède miracle. En utilisant de grands échantillons, on peut réduire ces incertitudes, mais une part d'incertitude reste inévitable en statistique. On peut les anticiper et en limiter l'ampleur. Ainsi, dans les questionnaires en ligne, l'ordre des options de réponse change automatiquement pour éviter que les participants ne cliquent toujours sur les trois premières réponses. Nous essayons en outre de formuler les questions aussi brièvement que possible et d'utiliser des images et des exemples. Autrefois, l'enquêteur apportait des précisions en cas de doute. Aujourd'hui, nous devons accorder plus d'attention à la conception des questionnaires pour qu'ils soient formulés aussi clairement que possible et il faut les tester avant leur utilisation. À cela s'ajoute la problématique des traductions au Luxembourg. La connotation négative d'un terme dans une autre langue peut influencer les réponses et nous donner parfois du fil à retordre. Par exemple, quand on demande à des personnes d'évaluer leur état de santé sur une échelle allant de « très mauvais » à « très bon », la traduction de « moyen » peut avoir différentes connotations selon la langue.
L'intelligence artificielle peut-elle contribuer à réduire la charge de travail ?
G.O. : L'IA peut apporter une aide lors du traitement des données. Par exemple, quand des informations sont recueillies sous la forme de réponses libres, l'IA peut analyser et catégoriser ces textes. L'IA est aussi un assistant utile pour l'analyse des données et a amélioré notre productivité. Mais en fin de compte, l'être humain doit toujours tout vérifier.
Auteure : Britta Schlüter
Édition : Michèle Weber (FNR)
Traduction : Nadia Taouil (www.t9n.lu)
Infobox
Le STATEC est l'Institut national de la statistique et des études économiques du Luxembourg. Cet institut est placé sous l'autorité du ministère de l'Économie, mais jouit d'une autonomie scientifique et professionnelle. Sa principale mission consiste à produire des statistiques, des études et des analyses pour fournir une image fiable et représentative de la situation économique, écologique et sociale du Luxembourg. L'institut de statistique emploie quelque 200 personnes et son siège est situé à Belval. Les étudiants, les chercheurs et les autres personnes intéressées peuvent également y consulter la bibliothèque spécialisée de l'institut. Le portail des statistiques du STATEC met à la disposition une multitude de chiffres ainsi que des actualités et des publications présentées de manière claire, dont la toute récente édition 2025 de la publication « Le Luxembourg en chiffres ». Comme il s'agit d'un service public, le personnel du STATEC se tient aussi à la disposition des citoyens pour fournir des renseignements statistiques. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les enquêtes du STATEC et leur importance dans cette vidéo YouTube.
En tant qu'organisme public de recherche biomédicale axé sur la santé de précision, le Luxembourg Institute of Health (LIH) a pour objectif de devenir une référence de premier plan en Europe afin de transformer l'excellence scientifique en avantages significatifs pour les patients.
Poussé par une obligation collective envers la société d'utiliser les connaissances et les technologies issues de la recherche basée sur les données dérivées des patients afin d'avoir une influence directe sur la santé humaine, le LIH place le patient au cœur de toutes ses activités. Ses équipes dévouées de chercheurs multidisciplinaires visent l'excellence et génèrent des connaissances pertinentes liées aux maladies immunitaires et au cancer.
L'Institut considère les collaborations, les technologies révolutionnaires et les processus d'innovation comme autant d'occasions uniques d'améliorer l'application des diagnostics et des thérapies, avec l'objectif de prévenir les maladies à long terme.








