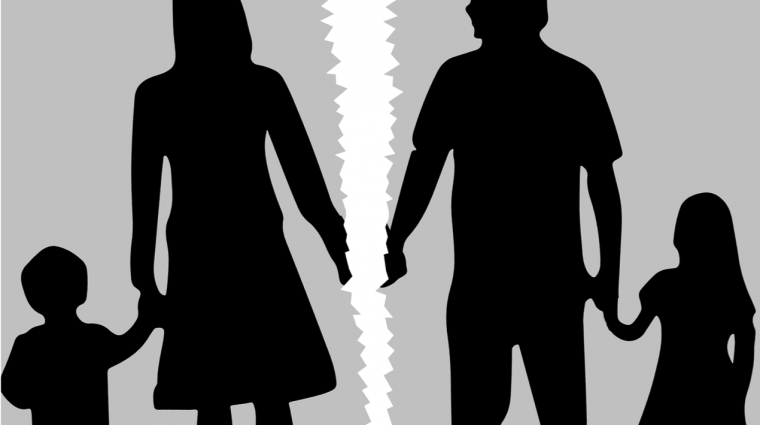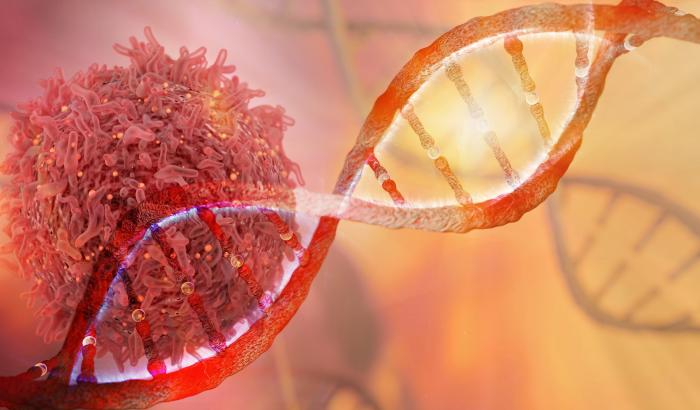(C) FNR
Gökhan Ertaylan, en tant que seul participant luxembourgeois au Lindau Nobel Laureate Meeting, vous avez eu récemment l'opportunité de rencontrer personnellement 37 prix Nobel en physiologie et en médecine. Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Elle a dépassé toutes mes attentes. De nos jours, un prix Nobel est un modèle pour les générations à venir, un peu comme un réalisateur qui gagné l'Oscar ou un auteur de bestsellers. À Lindau, j'ai pu observer et écouter par moi-même les avis et les histoires des scientifiques les plus brillants de ma génération au lieu de la version idéalisée véhiculée la plupart du temps dans les médias.
Et quelles ont été vos impressions ?
Les prix Nobel sont des Hommes avant tout. Ils font des erreurs comme les scientifiques moyens, voire parfois plus, mais ils ne renoncent jamais. Tous les prix Nobel que j'ai rencontrés lors de cette réunion travaillent à une idée pour la bonne et simple raison qu'ils sont intéressés et non pas parce qu'ils peuvent en tirer de la notoriété ou de la reconnaissance personnelle. J'ai été captivé de voir que la flamme de la passion pour la science pouvait encore brûler p. ex. chez une personne de 90 ans qui travaille depuis plus d'un demi-siècle dans la recherche !
Au LCSB, vous examinez les propriétés des cellules du cancer du sein constituant des métastases. Avez-vous eu de nouvelles idées pour votre projet à Lindau ?
Oui, absolument. Grâce à Elisabeth Blackburn d'Australie (prix Nobel en 2009) je comprends désormais mieux le processus de vieillissement des cellules et des tissus. Il est différent d'une personne à une autre. Avec la génétique et les influences environnementales, il pourrait jouer un rôle important dans le développement des maladies, comme le cancer du sein.
D'autre part, j'ai également compris que le scientifique d'aujourd'hui ne pouvaient plus se cantonner au schéma traditionnel du chercheur s'il veut avoir du succès dans son secteur.
Pourriez-vous être un peu plus précis ?
Selon l'approche classique, un chercheur en biologie ou en médecine est considéré comme un spécialiste dans sa branche s'il est en mesure de formuler des hypothèses, de prévoir et de réaliser des expériences et d'analyser des résultats. Il doit parallèlement lire et intégrer de nouvelles connaissances de la littérature spécialisée et veiller à ce que ses découvertes soient également publiées.
Au cours des 15 dernières années, de nouvelles technologies se sont développées si rapidement que nous pouvons à présent produire plus de résultats que nous ne pouvons en évaluer. Nous pouvons aujourd'hui séquencer l'ensemble du patrimoine génétique d'un homme en moins d'une semaine, mais nous avons besoin de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, pour exploiter les données. La même remarque s'applique à des publications : dans mon domaine de spécialisation par exemple, plus de 14.000 articles ont été publiés au cours des 12 derniers mois. Cela fait quasiment 40 publications par jour que je devrais théoriquement lire !
Qu'est-ce que les chercheurs peuvent faire contre cette impasse ?
De manière générale, nous avons besoin d'une collaboration forte et d'une bonne compréhension dans différentes disciplines. Pour la littérature technique, nous pouvons utiliser des algorithmes et des processus de collecte semi-automatiques tirés de l'informatique. Même pour l'analyse de données, nous utilisons l'ordinateur comme une extension de notre cerveau sans ignorer ici le contexte biologique. Il est par conséquent tout aussi important de revenir au laboratoire et de tester les résultats de l'analyse théorique.
Quelle méthode de travail gardez-vous de cette rencontre ?
Travaille à quelque chose qui t'intéresse vraiment. Ne trouve pas d'excuse !
Interview: Michèle Weber (FNR)
Photo © FNR
Infobox
La rencontre de juillet 2014 a permis de réunir 600 jeunes scientifiques de 80 pays, 37 prix Nobel en physiologie et en médecine dont Jules Hoffmann, né au Luxembourg et prix Nobel en 2011. C'est dans les années 1950, sous l'égide de la noble famille Bernadotte, que cet événement a été créé dans la charmante ville de Lindau avec pour objectif de regrouper l'élite scientifique et de jeunes chercheurs ultramotivés du monde entier. Depuis 2009, le FNR soutient 1 ou 2 scientifiques talentueux du Luxembourg pour participer à cette rencontre atypique. La procédure d'appel pour la prochaine rencontre Lindau Nobel Laureate Meeting à l'été 2015 est prévue pour octobre 2014.
Pour plus d'informations sur le Lindau Nobel Laureate Meeting: http://www.lindau-nobel.org
Depuis 2012, Gökhan Ertaylan est un collaborateur scientifique (post-doctorant soutenu par le FNR) dans le Computational Biology Group au Centre du Luxembourg pour la biomédecine des systèmes (LCSB) de l'université de Luxembourg. Après des études d'ingénierie électrique et électronique à l'université Boğaziçi d'Istanbul, ce Turc de naissance décide d'orienter sa carrière vers le biologie. Il passe un master en bioinformatique et en génétique à l'université d'Utrecht et s'intéresse ensuite pendant sa thèse à la biologie comuputationnelle et des systèmes à l'université d'Amsterdam pour le virus du VIH. Au LCSB, Gökhan travaille sur le cancer du sein: il recherche des modifications moléculaires apparaissant dans les cellules cancéreuses métastatiques. Des caractéristiques de ce type pourraient aider à l'avenir à répartir dans différents groupes, les patients atteints de cancer et à leur proposer une forme de traitement personnalisée. http://wwwde.uni.lu/lcsb/people/goekhan_ertaylan