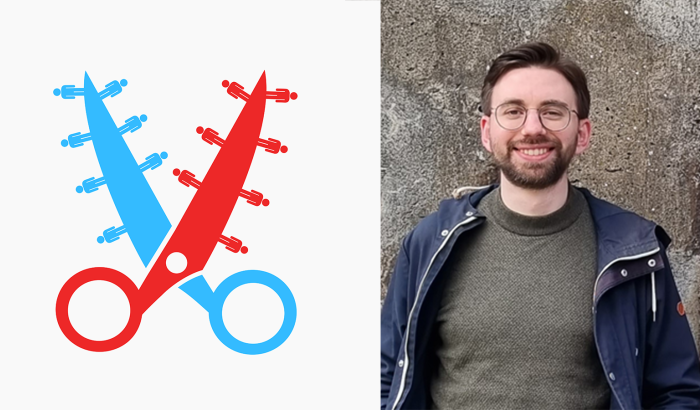Philippe Van Kerm est économiste spécialisé dans les inégalités et les politiques sociales à l’Université du Luxembourg
La pauvreté est un phénomène complexe qui cache de nombreux destins tristes et difficiles. Pour mieux comprendre le phénomène, nous avons parlé avec Philippe Van Kerm, économiste spécialisé dans les inégalités et les politiques sociales à l’Université du Luxembourg.
Philippe Van Kerm, il y a la pauvreté absolue, relative ou encore subjective. Comment s’y retrouver ?
Il est possible d’établir une hiérarchie de ces différents concepts. On parle d’abord de la pauvreté extrême, qui correspond à une situation dans laquelle la survie même n’est pas assurée. C’est le fameux « un dollar par jour » (ou 2,15 en 2024). Une telle situation de grande pauvreté est présente dans de nombreux pays autour du monde, mais est pratiquement inexistante en Europe.
On va dès lors étendre la notion de pauvreté. Il ne s’agit pas seulement de survie, mais également de vivre « dignement » et de pouvoir participer pleinement à la société. On peut définir les biens et services qui paraissent indispensables à une vie digne dans un pays riche. Il s’agit d’un critère absolu, car il n’est pas défini par rapport à une moyenne. Ceci dit, il varie quand même selon les pays et dans le temps : avoir accès à internet est considéré aujourd’hui comme essentiel pour vivre au Luxembourg, mais ne l’était pas il y a quinze ans.
Cette approche est néanmoins difficile et potentiellement arbitraire, car elle devrait également prendre en compte les préférences de chacun. On définit ainsi un second concept de pauvreté de revenu qui est relatif, en prenant une référence monétaire observée dans la population. On prend par exemple un seuil de 60 % du revenu médian (celui-ci partage la population en deux groupes de même taille, ndlr) sous lequel une personne se trouve « en risque de pauvreté ». Ce chiffre de 60 % est bien entendu arbitraire et réducteur, mais son adoption dans l’Union européenne permet des comparaisons entre pays et au cours du temps.
Les mesures de pauvreté basées sur le revenu ne reflètent toutefois pas parfaitement le vécu des individus. Certaines méthodes considèrent donc les aspects subjectifs, et demandent par exemple aux gens s’ils ont de la peine à boucler les fins du mois. Cette approche paraît intuitive, mais elle est peu utilisée dans les politiques sociales car sa fiabilité est discutable, les normes et les références différant d’un individu à l’autre. Il y a également un risque d’adaptation lorsqu’une personne finit par s’adapter à sa condition et considère comme acceptable une situation qui serait jugée comme intolérable par la majorité.
La pauvreté relative considère des moyennes nationales. Ne faudrait-il pas prendre en compte les différences régionales et internationales ? On se compare aussi aux personnes vivant dans les pays voisins.
On pourrait imaginer un seuil de pauvreté établi sur la médiane des revenus dans l’UE, mais l’objectif des comparaisons internationales est d’analyser l’exclusion au sein de chaque pays, pas d’établir un classement des pays les plus riches. Les politiques sur la pauvreté sont des décisions prises à l’échelle nationale, et exigent donc une vision nationale du problème.
Comment comprendre l’augmentation de la pauvreté relative au Luxembourg ?
Cette évolution de la pauvreté relative est intrinsèquement liée à la croissance des inégalités : les bas revenus ont augmenté moins vite que le revenu médian servant à définir le seuil de pauvreté. Le défi pour stopper l’augmentation de la pauvreté relative est de parvenir à une croissance des bas revenus qui soit en ligne avec celle du revenu médian.
Que dit la science sur les moyens de lutter contre la pauvreté ?
Pour les spécialistes – autant dans la recherche que dans les administrations –, il faut agir sur deux aspects complémentaires. Le premier est direct : on soutient les revenus des gens les plus défavorisés par des transferts monétaires, que ce soit sous forme de réductions d’impôts, d’allocations sociales, d’aides au logement ou encore de chèques pour la garde des enfants. Le filet de sécurité sociale doit assurer un niveau de vie minimum décent et éviter que des gens ne glissent entre ses mailles.
Le second axe est indirect et vise à développer le « capital humain ». Il s’agit d’amener les personnes en situation de précarité à avoir elles-mêmes les moyens d’améliorer leurs conditions de vie – principalement via l’emploi – grâce à des soutiens à la recherche d’emploi et à des formations adaptées. On doit également penser à soutenir la scolarité des enfants en situation de précarité. Il s’agit à la fois de lutter contre les effets de la pauvreté et contre les facteurs qui la renforcent, car la pauvreté peut générer un cercle vicieux.
Les responsables politiques voient-ils également les choses ainsi ?
En Europe, la politique est globalement en accord avec ces approches. Les gouvernements vont déplacer le curseur tantôt vers les aides directes – plus ou moins « généreuses » –, tantôt vers les aides indirectes, mais on retrouve toujours une combinaison de ces approches.
L’idée de miser exclusivement sur la croissance économique pour éliminer la pauvreté n’est plus d’actualité : il est désormais clair que la richesse ne ruisselle pas de manière automatique vers le bas. La croissance doit être équilibrée. Il faut l’accompagner de mécanismes de protection sociale ainsi que d’une fiscalité et d’une redistribution équitables. Un large consensus existe désormais sur ce sujet, y compris au sein des grandes institutions internationales telles que la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international.
La pauvreté stigmatise. Un problème ?
La honte de la précarité – le regard des autres ou le sien – reste importante, notamment lorsque la pauvreté touche les enfants. Ce stress psychologique s’ajoute aux difficultés matérielles de la pauvreté et la stigmatisation peut engendrer une dynamique contre-productive. En effet, de nombreuses personnes ne font pas les démarches pour obtenir les aides auxquelles elles ont droit. Elles n’en ont pas connaissance, sont intimidées par les procédures à suivre, ou préfèrent ne pas avoir recours à l’aide sociale en raison de la stigmatisation qui y est encore associée.
Plus d’infos sur le sujet:
Auteur : Daniel Saraga
Rédacteur : Jean-Paul Bertemes (FNR)