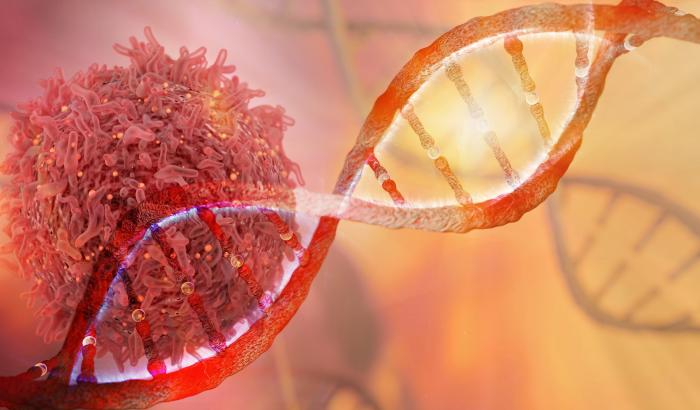Si les bactéries inoffensives dans nos intestins ne reçoivent pas de fibres végétales, elles se mettent à dévorer leur hôte de l’intérieur. Ce résultat est issu d'une nouvelle étude du LIH.
Un régime alimentaire équilibré doit inclure une quantité importante de fibres, et cela a pendant longtemps été le cas puisque nous avions l’habitude de consommer des portions de fruits et légumes apportant jusqu’à 100g de fibres par jour.
Au cours des dernières décennies cependant, la consommation plus élevée d’aliments industriels déjà transformés et l’évolution de nos modes de vie a fait diminuer ces quantités de manière drastique, ce qui a été lié à une augmentation des cas de maladies intestinales comme les cancers du côlon et les maladies inflammatoires de l’intestin. Mais pourquoi ?
Les bactéries dévorent la barrière mucosale de la paroi intestinale
Pour répondre à ces questions, Dr Mahesh Desai, à la tête du groupe de recherche Ecoimmunology and Microbiome du Luxembourg Institute of Health (LIH) et Dr Eric Martens, University of Michigan Medical School, USA ont imaginé et dirigé un projet de recherche. Ce projet a permis de reproduire le fonctionement du système intestinal humain grâce à des souris nées sans microbiote intestinal. Ces souris, dites gnotobiotiques, ont ensuite reçu un cocktail de 14 bactéries vivant habituellement dans l’intestin humain, et dont l’activité a pu être suivie dans le temps. De telles expériences permettent aux chercheurs d'étudier le comportement de bactéries précis dans un organisme vivant et dans des conditions contrôlées.
En nourrissant certaines souris avec un régime riche en fibres alimentaires et d’autres avec un régime les excluant, les chercheurs ont pu découvrir que les bactéries privées de fibres, et donc de nourriture, étaient en mesure de modifier leur comportement pour compenser ce manque. Il se nourrissent alors de la barrière mucosale qui tapisse le système intestinal et sert de première ligne de défense dans le système immunitaire, nous protégeant contre les agressions extérieures.
La même problème avec compléments alimentaires prébiotiques classiques
“Nous avons découvert un mécanisme qui montre qu’une consommation réduite de fibres rend certaines de nos gentilles bactéries intestinales absolument furieuses!” explique Dr Desai, auteur principal de l’étude.
D’autres souris ont également été nourries avec un régime excluant fruits et légumes mais intégrant des compléments alimentaires prébiotiques classiques. Les compléments prébiotiques contiennent des aliments importants pour la croissance des bactéries bénéfiques dans l'intestin. Résultat ? Il se passe exactement la même chose que dans le cas d’un régime excluant toutes fibres alimentaires.
“Ces résultats sont absolument fantastiques et ouvrent des perspectives pour la mise au point d’une nouvelle génération de prébiotiques. Des suppléments alimentaires ciblant l’action du microbiote intestinal humain pourraient ainsi jouer un rôle intéressant dans le traitement et la prévention des maladies du système intestinal“, déclare Prof. Markus Ollert, Directeur du Department of Infection and Immunity au Luxembourg Institute of Health.
Prochaine étape: étudier les biomarqueurs
Dans la lignée de ce projet de recherche, Dr Desai et Dr Martens souhaitent à l’avenir étudier les possibles biomarqueurs qui permettraient de déterminer l’état de la barrière mucosale d’un individu, ainsi que les effets d’un régime pauvre en fibres sur des maladies comme les cancers du côlon et les maladies inflammatoires de l’intestin.
“Si ce projet de recherche a été menée sur des souris, le message général qui ressort de cette étude renforce le discours diffusé par les médecins et les nutritionnistes depuis des années : Mangez beaucoup de fibres, de sources naturelles variées ! » conclue le Dr Eric Martens.
Cette étude, qui a principalement été financée par le FNR ainsi que par le LIH, a été menée en collaboration avec l’Université de Luxembourg, Washington University School of Medicine et l’Université Aix-Marseille. Les résultats de cette étude ont été publiés dans le journal scientifique “Cell”.
Auteur: LIH
Photo © LIH
Infobox
Les probiotiques sont des compléments alimentaires contenant des souches bactériennes bénéfiques pour la santé, tels que les bactéries lactiques. Les prébiotiques par conte sont des compléments alimentaires contenant des aliments pour les bactéries bénéfiques déjà présentes dans l'intestin, stimulant ainsi leur croissance et prolifération.
L’abattage intensif dans l’intestin
L’étude a donc montré que la couche de mucus tapissant l’intestin devenait plus fine si les souris recevaient une alimentation pauvre en fibres. Si le mucus est normalement produit et dégradé en permanence, le changement de comportement de ces bactéries « affamées » par un manque de fibres amène à une situation dans laquelle le mucus est mangé plus rapidement qu’il n’est produit – presque comme l’abattage intensif dans une forêt ou les arbres nouvellement plantés n’auraient pas le temps de pousser. Ces bactéries érodent même la barrière mucosale tellement rapidement qu’elles créent des failles immunitaires.
Die Studie zeigt, dass die Schleimschicht im Darm dünner wird, wenn die Mäuse weniger Ballaststoffe erhalten. Auch wenn der Schleim in einem normal funktionierenden Darm ständig nachproduziert und wieder abgebaut wird, bedeutete die Veränderung der Bakterienaktivität unter der höchsten Stufe des Ballaststoffentzugs, dass die Geschwindigkeit, mit der die Bakterien die Schleimschicht auffraßen, höher war als die Geschwindigkeit, mit der mehr Schleim produziert werden konnte. Vergleichen kann man diesen Raubbau vielleicht mit der Abholzung eines Waldes, der nicht schnell genug durch nachgepflanzte Bäume ersetzt werden kann. Die Schleimschicht wird sogar so weit erodiert, dass gefährliche Bakterien von außen eindringen und zu schweren Entzündungen der Darmwand führen können.